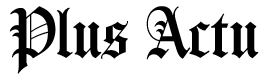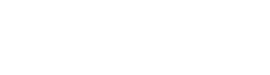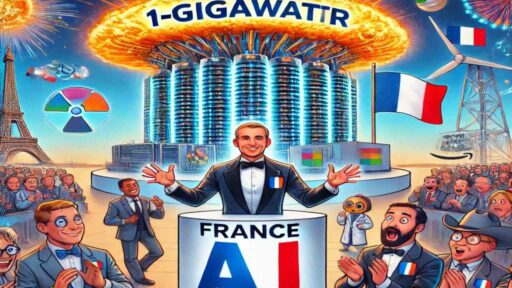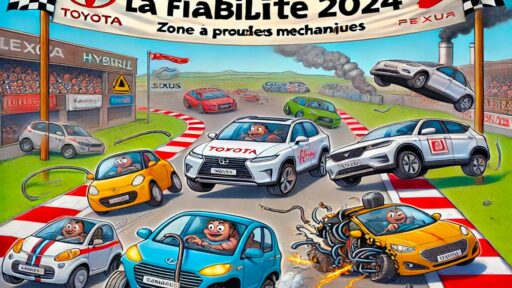Donald Trump est de retour, et avec lui, ses méthodes de cow-boy en économie. Le magnat de l’immobilier reconverti en président de la première puissance mondiale dégaine de nouveau l’arme des tarifs douaniers, sans préavis, sans concertation, et avec la subtilité d’un bulldozer sur un champ de tulipes. Son dernier coup de poker ? Une augmentation massive des droits de douane contre le Canada, le Mexique et la Chine, trois des principaux partenaires commerciaux des États-Unis.
L’éditorial du Wall Street Journal ne s’y trompe pas et qualifie cette décision de « pire guerre commerciale de l’histoire ».
Le protectionnisme version Trump : l’art de se tirer une balle dans le pied
Dans sa croisade pour rendre l’Amérique « grande », Trump persiste à penser que l’autarcie est un modèle viable en 2025. Augmenter de 25 % les taxes sur les importations canadiennes et mexicaines, et de 10 % celles sur les produits chinois, c’est d’abord une manière d’envoyer un message fort : « L’Amérique d’abord, les amis ensuite ». Mais comme le rappelle le Journal, « il est risqué d’être l’ennemi des États-Unis, mais c’est souvent mortel d’en être l’ami ».
Pourquoi ces tarifs ? Officiellement, pour réduire les déficits commerciaux abyssaux des États-Unis et protéger les travailleurs américains. Officieusement, c’est un coup de com’ électoraliste pour rassurer l’Amérique profonde, en brandissant la menace du « grand remplacement industriel » par des produits étrangers. Trump ne cache d’ailleurs pas son fantasme d’une économie « fermée », qui produirait tout en interne, dans une vision réminiscente des plans quinquennaux soviétiques.
Des répercussions économiques prévisibles et imprévisibles…
Derrière l’effet d’annonce, la réalité est tout autre. D’abord, l’inflation va grimper. Le Budget Lab de Yale estime que ces nouvelles taxes coûteront entre 1 000 et 1 200 dollars par an aux ménages américains. Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor, qualifie cette mesure de « choc d’offre auto-infligé » : si vous taxez les produits étrangers, les prix montent, point. C’est de l’économie de base, mais visiblement pas celle de la Trump University.
Ensuite, les partenaires commerciaux ne comptent pas se laisser faire. Le Canada et le Mexique annoncent déjà des contre-mesures similaires, tandis que la Chine prépare une plainte à l’OMC. Justin Trudeau a déclaré que son pays appliquerait des tarifs équivalents sur 155 milliards de dollars d’importations américaines. Quant à Claudia Sheinbaum, présidente du Mexique, elle contre-attaque en démontrant que son pays a déjà pris des mesures contre le trafic de fentanyl, prouvant ainsi que l’argument de Trump est bancal.
Le rêve protectionniste Trumpiste face à la réalité de la mondialisation
Au-delà des postures, cette politique protectionniste révèle surtout un archaïsme total sur la vision de l’économie. Aujourd’hui, une voiture « américaine » contient des pièces venant de dizaines de pays, tout comme un smartphone « chinois » intègre des composants développés aux États-Unis et produits en Corée du Sud. L’industrie moderne repose sur des chaînes d’approvisionnement mondiales, pas sur un mur de tarifs douaniers.
L’approche de Trump ressemble à celle d’un chef d’entreprise qui réduirait les coûts en virant ses clients. Comme le souligne William Reinsch, expert du commerce international, si certains produits peuvent être stockés en prévision des tarifs (acier, bois), ce n’est pas le cas des produits périssables : « On ne stocke pas des avocats, des fleurs coupées ou des bananes ».
Une stratégie qui coûtera cher à l’Amérique
Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, adopte une position plus nuancée en expliquant que les tarifs « peuvent être une arme économique utile », à condition qu’ils soient stratégiques. Or, ici, on assiste plutôt à une course à l’échalote avec des conséquences majeures : inflation, perte de compétitivité et tensions diplomatiques accrues. En un mot, un cocktail explosif.
Déjà, les républicains modérés commencent à s’inquiéter. Le sénateur Mark Warner rappelle que Trump avait promis de baisser les prix des courses alimentaires et qu’au lieu de cela, « il fait exactement le contraire ».
Vers un retour à la raison de Trump ?
Peu probable. Trump a toujours aimé le choc et la confrontation. En revanche, l’impact de cette politique risque d’être rapidement ressenti par les Américains moyens, qui verront leurs factures grimper. D’ici là, il est fort à parier que Trump, fidèle à lui-même, accusera les médias, les démocrates, ou pourquoi pas « le lobby des tarifs » de comploter contre lui.
L’histoire économique l’a déjà montré : une guerre commerciale ne profite à personne. Trump veut réécrire les lois de l’économie, mais les faits sont têtus. Et ils risquent de lui revenir en pleine figure, plus vite qu’il ne le pense.