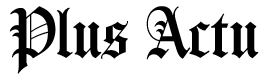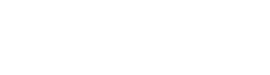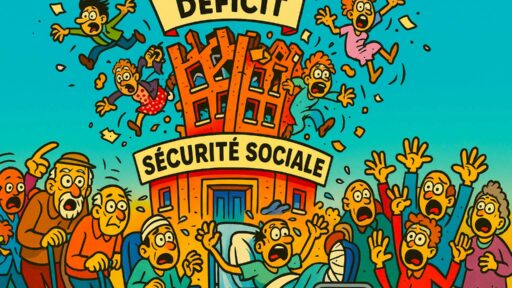L’Europe face au mur de la croissance molle
Depuis 15 ans, l’Europe (hors Irlande, Pologne ou pays baltes) connaît une stagnation quasi chronique. Le PIB croît lentement, l’investissement productif reste faible, et la démographie pèse lourdement : le continent vieillit, et ne renouvelle pas assez ses générations.
- L’Allemagne n’est plus le moteur industriel qu’elle était : vieillissement accéléré, dépendance aux exportations chinoises, et crise énergétique post-gaz russe l’ont fragilisée.
- La France, avec un tissu industriel érodé, une dette colossale (près de 3 100 milliards €) et une fonction publique surdimensionnée, peine à retrouver un cap.
- L’Italie, étranglée par sa dette et un vieillissement démographique aigu, est dans une situation pré-déflationniste chronique.
- L’Europe de l’Est, elle, connaît une croissance relative, mais dépendante des délocalisations ou de l’effet rattrapage qui touche à sa fin.
Conclusion provisoire ? Une Europe à deux vitesses, mais avec un moteur globalement grippé.
Des plans écomomiques… sans souffle stratégique
Certes, des plans existent :
- Le Green Deal européen veut investir 1 000 milliards d’euros d’ici 2030 pour décarboner l’économie.
- Le plan REPowerEU cherche à sortir du gaz russe et booster les énergies renouvelables.
- Des projets de cloud souverain, d’usines de batteries, ou de puces électroniques (comme le Chips Act européen) visent à réduire la dépendance.
Mais le problème de l’Europe est moins l’ambition que la mise en œuvre : bureaucratie kafkaïenne, fragmentation nationale, lenteurs politiques… Et surtout une absence de vision stratégique commune.
Le déficit de puissance technologique et industrielle
L’Europe est absente des grandes révolutions technologiques :
- Pas de leader dans l’IA (ni infrastructure, ni modèle fondamental),
- Pas de géant du cloud (AWS, Google Cloud, Azure dominent),
- Pas de champion des réseaux sociaux, du hardware ou du quantique.
Même dans des secteurs industriels où elle brillait (automobile, chimie), l’Europe subit désormais la concurrence chinoise ou américaine avec retard à l’adaptation. Et pendant ce temps, l’Union dépend technologiquement des autres puissances, y compris pour ses propres politiques écologiques (panneaux solaires, batteries, etc.).
Une dépendance énergétique durable
L’illusion que le nucléaire français suffisait à protéger l’UE s’est effondrée avec la fermeture partielle de Fessenheim, les retards d’EPR et la désindustrialisation énergétique allemande.
- Résultat : l’Europe importe massivement son énergie à prix fort, grevant la compétitivité des entreprises.
- Le choc énergétique de 2022 a révélé cette faiblesse, et même si les prix se sont tassés, le fond du problème reste entier : dépendance, absence de vision commune, tensions internes.
Vers quoi pourrait tendre l’Europe ?
Le scénario optimiste serait une fédéralisation partielle : un vrai budget européen, une politique industrielle commune, un plan de formation et de reconquête technologique. Cela suppose de dépasser les égoïsmes nationaux.
Le scénario pessimiste, plus plausible aujourd’hui, c’est une Europe en décrochage stratégique, qui devient un terrain d’influence entre Chine et États-Unis, sans moteur propre. Une Europe musée, subventionnée, vieillissante, peu innovante. Une périphérie du monde qui fut pourtant son centre.
Parler vrai, agir clair : le vrai défi européen
Il ne s’agit pas de catastrophisme, mais de lucidité : le projet européen est en crise de souffle plus qu’en crise d’existence. Il vit, mais sans direction claire. Ce qui manque aujourd’hui, ce n’est pas une nouvelle réforme ou un énième plan de relance, c’est une prise de conscience existentielle : que voulons-nous être en 2030 ? Des spectateurs technologiques ? Des gestionnaires de subventions ? Ou des bâtisseurs d’une souveraineté stratégique européenne, réelle et assumée ?
Encore faut-il oser poser la question. Et oser y répondre.