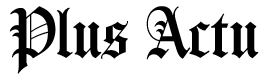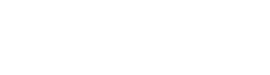Ressentiment africain d’un héritages douloureux
Le ressenti africain vis-à-vis de la France : une mémoire longue, fracturée, entretenu par une propagande étrangère, c’est plus de 180 ans d’histoire dure à comprendre et plus encore à résumer.
L’histoire des relations entre l’Afrique et la France est un récit complexe, tissé de blessures anciennes, de dominations assumées et de malentendus persistants. Ce passé, souvent douloureux, continue de façonner les perceptions contemporaines. Le ressentiment, parfois exploité, parfois légitime, s’enracine dans une mémoire longue, fragmentée et partagée entre mémoire imposée et récit réapproprié.
L’esclavage, aboli en France en 1794 puis définitivement en 1848, reste une plaie ouverte. Bien que la traite des esclaves ait pris diverses formes dans l’histoire, la France est encore perçue comme l’un des symboles majeurs de cette oppression. Cette mémoire, souvent instrumentalisée par d’autres puissances, peine à devenir un lieu de réconciliation. Il manque une parole partagée, équilibrée, qui reconnaîtrait sans réduire ni essentialiser.
Pendant la Première Guerre mondiale, environ 200 000 Africains ont été envoyés combattre sous le drapeau français (souvent de force). Beaucoup ne sont jamais revenus, et ceux qui ont survécu ont été traités comme des citoyens de seconde zone. Le massacre de Thiaroye en 1944, où des tirailleurs sénégalais furent tués pour avoir simplement réclamé leur solde, incarne cette inégalité persistante entre mémoire française et réalité vécue en Afrique.
Le franc CFA, créé après 1945, a longtemps servi de lien économique, mais aussi de chaîne dorée dirigé depuis Paris. Il a assuré une certaine stabilité monétaire, tout en limitant fortement la souveraineté des nations africaines. Sa réforme récente, en 2020, n’efface pas l’image d’une monnaie perçue comme coloniale et imposée (à l’image du dollar US ailleurs).
Le découpage arbitraire des frontières africaines lors de la conférence de Berlin en 1884-85 a laissé un héritage explosif. En divisant des peuples ou en fusionnant de force des entités rivales, les puissances coloniales, dont la France, ont structuré une géographie du conflit. Ce découpage continue de nourrir tensions, guerres civiles et haines interethniques.
Après les indépendances des années 1960, la France a mis en place un système d’influence indirect : la Françafrique. Des accords secrets, des présidents alliés, des réseaux comme ceux de Jacques Foccart, et des entreprises stratégiques (Elf, Bouygues, Areva) ont permis à la France de conserver l’accès aux ressources naturelles contre stabilité politique. Ce pacte tacite a contribué à étouffer la démocratie locale et à entretenir une classe dirigeante cooptée.
La fin de la guerre froide en 1989 aurait pu être l’occasion d’une refondation. Le discours de La Baule, en 1990, promettait un lien nouveau entre démocratie et aide financière. Mais rien n’a vraiment changé. Les réseaux de la Françafrique ont perduré, et la jeunesse africaine, privée d’alternative, a vu en la France le gardien d’un système verrouillé, un pays ennemie.
Présence de la France en Afrique controversées
La France reste pourtant l’un des plus importants contributeurs à l’aide publique au développement, avec plus de 11 milliards d’euros chaque année, dont une grande partie pour l’Afrique. Santé, éducation, climat, infrastructures : l’effort est réel. Mais il est souvent brouillé par les lenteurs administratives françaises, les détournements locaux et l’éloignement des populations bénéficiaires.
Quelques belles action tout de même, exemple :
“En janvier 2013, alors que les colonnes djihadistes de l’alliance entre Ansar Dine, AQMI et le MUJAO (souvent assimilées à l’influence de Boko Haram par amalgame médiatique) fonçaient vers le sud du Mali, la ville de Bamako semblait à portée de fusil. L’armée malienne, désorganisée, sous-équipée, démoralisée et souvent impayée, s’est effondrée face à l’offensive. Des régiments entiers ont déserté sans combattre, parfois en abandonnant leur matériel. Le pays sombrait dans une panique silencieuse.
C’est dans ce contexte que la France lança l’opération Serval, à la demande du président malien par intérim, Dioncounda Traoré. Une force d’à peine 4 000 soldats français, soutenue par quelques moyens aériens et des troupes africaines en renfort, parvint en quelques semaines à reprendre les principales villes du nord, de Gao à Tombouctou, puis à repousser les groupes armés dans le massif des Ifoghas.
L’intervention fut saluée localement comme un sauvetage. Ce que l’on oublie souvent, c’est qu’il n’aura fallu qu’un corps expéditionnaire limité, avec une coordination efficace, pour faire reculer une menace existentielle là où l’armée nationale avait échoué. «
Cette réussite rapide accentua paradoxalement le sentiment de dépendance, ravivant ensuite le ressentiment lorsque la présence militaire française se prolongea sans solution politique durable.
Les opérations militaires françaises, Serval puis Barkhane, ont marqué une tentative sincère d’appui à la stabilité régionale. Mais mal comprises, mal relayées, elles ont fini par être perçues comme un retour au contrôle. En 2022, les troupes françaises quittent le Sahel, dans un climat de rejet inédit. Le vide ainsi laissé devient un champ de conquête pour d’autres.
La Russie, par le biais du groupe Wagner, propose des services de sécurité en échange d’accès aux ressources naturelles, sans aucun respect du droit international. La Chine investit massivement, sans parler de démocratie. Les groupes islamistes comme Boko Haram ou l’État islamique imposent leur ordre par la violence. Aucun de ces acteurs ne propose un horizon émancipateur. Ils s’engouffrent dans un ressentiment que personne n’a pas su désamorcer.
Reconfigurations nécessaires
Mais il serait malhonnête de ne pointer que la France. Une part de la responsabilité incombe aussi aux États africains eux-mêmes. Corruption chronique, élites déconnectées, tribalisme réactivé à des fins politiques, répression des contre-pouvoirs : ces facteurs internes alimentent l’instabilité. Les peuples africains, trop souvent pris en otage entre intérêts extérieurs et gouvernements autoritaires, aspirent à une vraie refondation.
Cette domination ne se joue pas que par la force ou l’économie : elle s’exerce aussi à travers la culture, l’éducation, la langue. Le système scolaire hérité, les normes administratives, le droit, tout est encore calqué sur la métropole. La décolonisation des structures intellectuelles n’a pas eu lieu. La jeunesse enrage contre une modernité imposée qui ne lui ressemble pas.
Et que dire des élites franco-africaines ? Formées à Paris, souvent complices du système, elles ont joué le rôle d’intermédiaires entre la France et leurs peuples. Leur double loyauté est aujourd’hui perçue comme une trahison, voire comme une prolongation postcoloniale. La diaspora, entre attachement et dénonciation, incarne cette tension non résolue.
Un panafricanisme nouveau émerge, plus radical, plus virulent. Il s’alimente de vidéos virales, de récits déformés, parfois de propagande. Des figures médiatiques comme Kemi Seba captent une jeunesse désillusionnée. Le rejet de la France devient un vecteur d’identité. Mais derrière l’appel à la souveraineté, certains discours sombrent dans le populisme, l’antisémitisme ou l’instrumentalisation géopolitique.
Enfin, impossible d’oublier le rôle ambigu des grandes entreprises françaises. Bolloré, Bouygues, Total, Areva… ont construit routes, ports et réseaux logistiques. Mais à quel prix ? Monopoles, accaparement des ressources, ententes opaques avec les régimes : leur action a parfois renforcé la dépendance plus qu’elle n’a soutenu le développement. Vincent Bolloré, en particulier, a incarné une forme de néocolonialisme logistique, maquillé sous les habits de la modernité.
Aujourd’hui, l’Afrique n’a pas besoin de pitié ni de présence militaire. Elle a besoin de partenaires qui respectent sa souveraineté, écoutent ses peuples, soutiennent ses forces vives sans les dévorer. La France, elle, doit sortir de la nostalgie et comprendre que sa grandeur d’hier ne vaut rien sans la confiance de demain.
Il est temps de construire une mémoire partagée, un avenir lucide. Le ressentiment ne disparaîtra pas par des excuses symboliques ni par des discours technocratiques. Il faut écouter, reconnaître, réparer, et avancer sans arrogance.
La mémoire est une arme, mais aussi un outil de réparation
Ce sujet, ce n’est pas une guerre d’arguments. C’est un miroir :
- La France s’y regarde, souvent mal, avec orgueil ou culpabilité.
- L’Afrique y cherche justice, mais parfois aussi vengeance ou instrumentalisation.
Entre les deux, je ne choisis pas un camp.
Je choisis la nuance comme résistance, la mémoire comme matière vivante, et la responsabilité partagée comme seule voie de sortie.
Alors non, la France n’est pas créolisée.
Non, elle n’est pas structurellement corrompue.
Mais oui, elle a failli, souvent.
Et oui, l’Afrique a droit à mieux que des injonctions ou des reliquats d’empire.
Le divorce franco-africain n’est pas définitif. Mais sa réconciliation demandera humilité, clarté, courage. Enfin, il nous faut refuser à la fois la cécité et l’autoflagellation.
A écouter :
La fin des accords de Défense entre la France et ses ex-colonies africaines 58′