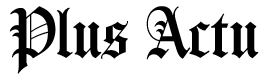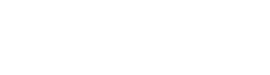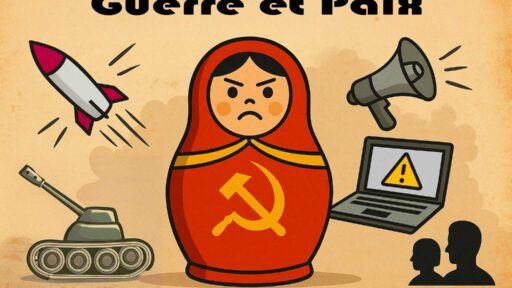Une paix devenue réflexe, une jeunesse devenue exception
Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, un paradoxe européen saute aux yeux : l’Europe soutient, mais ne s’engage pas. On applaudit la résistance ukrainienne, on finance, on équipe, on forme. Mais pas une armée européenne ne franchit le pas du front. Et surtout, on s’interdit d’y envoyer nos jeunes.
Pourquoi une telle prudence ? Pourquoi ce refus d’envisager une guerre contre la Russie, même au nom de principes que l’Europe défend pourtant sans relâche ? Derrière les discours diplomatiques se cache une réalité brute : la guerre est devenue un tabou existentiel, et la jeunesse, une espèce protégée et ce malgré elle.
Démographie : chaque jeune devient un capital national
Il faut commencer par le chiffre qui conditionne tout : 1,68 enfant par femme en France en 2023, contre 2,0 en 2010. En Allemagne, on est à 1,46. En Espagne, 1,19. En Italie, 1,24. Et dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, le taux frôle les 1,3, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations (2,1 enfants par femme).
À ce niveau, chaque naissance devient un enjeu stratégique, chaque jeune adulte un atout national qu’on hésite à exposer.
Autrement dit : quand on a peu d’enfants, on évite de les envoyer à la guerre. Ce n’est pas seulement un réflexe de société aisée, c’est une logique arithmétique. Perdre 1 000 jeunes dans un pays à haute natalité, c’est absorbable. Dans un pays vieillissant, c’est un traumatisme.
La mort d’un jeune soldat n’est plus une tragédie parmi d’autres. Elle devient une blessure collective, qui entame l’idée même de futur.
La culture de la paix : protection ou paralysie ?
Depuis 1945, l’Europe a fait de la paix le socle de son identité. C’est compréhensible : deux guerres mondiales en trente ans ont laissé un champ de ruines. L’Union européenne elle-même est née d’un refus du conflit armé, avec comme promesse implicite : plus jamais ça.
Mais cette culture de la paix s’est transformée en culture de la dépolitisation militaire. En France, seuls 6 % des jeunes déclarent envisager une carrière militaire. En Allemagne, l’armée peine à recruter, malgré les tensions croissantes. Partout en Europe, le refus de la guerre est devenu réflexe, presque superstition.
Résultat : même lorsque l’histoire s’invite à nos portes, nous restons accrochés à l’idée que la guerre est archaïque, réservée aux autres, évitable à coup de traités et de sanctions économiques.
L’exemple ukrainien : préserver les 18-25 ans, même en pleine guerre
Et pourtant, même dans les pays confrontés au tragique, ce réflexe existe. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a explicitement repoussé l’idée d’envoyer les 18-25 ans au front. Il privilégie les hommes plus âgés, souvent déjà pères, parfois anciens militaires ou réservistes.
Ce choix n’est pas qu’un calcul politique : c’est une stratégie civilisationnelle. Il s’agit de préserver ceux qui devront reconstruire le pays, penser l’après-guerre, porter l’économie, faire société.
Ce détail, souvent ignoré en Europe de l’Ouest, devrait nous interroger. Même un pays dévasté, menacé dans son existence, fait le choix de préserver sa jeunesse, non pas par mollesse, mais par lucidité à long terme.
L’Europe face à sa jeunesse : protection ou démission ?
Reste un doute. Ce souci de protection en Europe n’est-il pas aussi une forme d’abdication ? Car si préserver la jeunesse est nécessaire, la maintenir dans l’illusion d’un monde sans danger est une erreur plus profonde encore.
L’Europe a surprotégé ses jeunes en les dispensant d’effort collectif : pas de service national obligatoire, peu d’initiatives civiques de grande ampleur, une vision souvent individualiste du destin. Résultat : une génération à qui on ne demande presque rien, mais à qui on pardonne presque tout.
On craint de la brusquer, de la politiser, de la responsabiliser trop tôt.
Mais cette indulgence permanente n’a rien d’un projet d’avenir. Elle entretient un vide. Et dans ce vide, d’autres influences s’installent.
Arrêtons de prendre notre jeunesse pour des ignorants et des feignants. Ils ont certainement plus conscience que nous des enjeux qui les attendent. Mais voilà ils n’ont peut-être plus foi en notre démocratie et c’est là que le bât blesse.
La vraie question : peut-on défendre la paix sans préparation au conflit ?
L’Europe veut la paix. Elle a raison. Mais elle doit affronter cette vérité : la paix ne tient que par la force que l’on est prêt à opposer à ceux qui la bafouent.
Si l’on n’ose pas mobiliser nos jeunes, si l’on s’interdit de parler de guerre, si l’on confond désarmement moral et supériorité éthique, alors on offre un boulevard à ceux qui assument la violence comme langage géopolitique.
Préserver notre jeunesse, oui. Mais la former, lui donner des repères, des responsabilités, une conscience collective, voilà l’urgence. Pas pour l’envoyer mourir. Mais pour qu’elle soit prête. Car un monde où l’on refuse de voir le tragique est un monde qui finit toujours par le subir.
Si vis pacem para bellum
Végèce
Qui désire la paix, se prépare donc à la guerre
La paix que l’Europe chérit est précieuse… mais fragile
La paix que l’Europe chérit est un fruit précieux, mais fragile. La croire éternelle, c’est déjà l’exposer.
Il ne s’agit pas de glorifier la guerre, mais de se préparer à défendre ce qui nous est cher. La paix n’est pas un droit gravé dans le marbre : c’est une conquête, à renouveler génération après génération.
Ce n’est pas en débranchant notre jeunesse de l’effort collectif que nous la protégerons. C’est en l’associant pleinement à ce qui la dépasse, à ce qui la transcende.
Et peut-être faut-il le dire clairement : la jeunesse, elle, a compris les enjeux. Elle n’est pas fuyante, ni naïve. Elle est prête. Elle attend qu’on lui donne sa place, qu’on lui parle vrai. Ce ne sont pas les jeunes qui reculent : ce sont souvent leurs aînés qui, croyant les protéger, freinent leur engagement.
Ce n’est pas d’un cocon qu’ils ont besoin. C’est d’un cap.