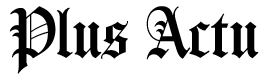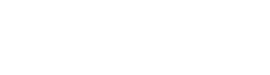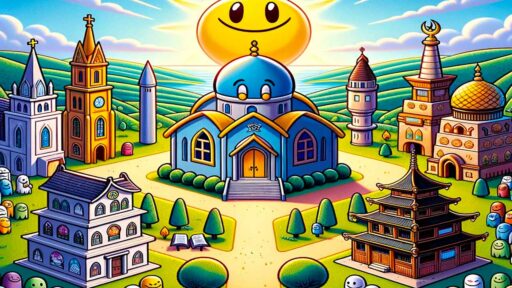La cérémonie en hommage à Charlie Kirk, figure de la droite conservatrice américaine récemment assassinée, a offert une scène saisissante. Deux voix, deux mondes.
D’un côté, Erika Kirk, son épouse, a déclaré dans un contexte de deuil, de fraternité, de pardon « Mon mari Charlie voulait sauver les jeunes hommes, comme celui qui a pris sa vie ».
Et elle a aussi insisté sur le pardon : « La réponse à la haine n’est pas la haine, mais l’amour (…) même pour nos ennemis. » Un message bouleversant de pardon, presque christique, qui a marqué les esprits dans un moment particulièrement fort.
De l’autre, Donald Trump, venu saluer la mémoire d’un allié idéologique, a lancé une phrase sans équivoque : « I hate my opponent(s). » (Je hais mes adversaires.)
Le contraste est brutal : le pardon contre la haine. La compassion contre la guerre des camps.
La guerre intérieure : des mots aux actes
Ce n’était pas un dérapage isolé. Depuis des années, Trump construit son récit autour d’un ennemi intérieur. Les démocrates sont des “traîtres”, les médias des “ennemis du peuple”, les juges qui le contredisent des “corrompus”.
Mais il ne s’est pas contenté de mots. Lorsqu’il a mobilisé la Garde nationale en Californie – alors que cet usage relève normalement du gouverneur et non du président – il a franchi une ligne. Envoyer des militaires pour s’opposer à des décisions locales, c’est traiter une divergence politique comme une insurrection. C’est transformer l’opposition démocratique en ennemi à abattre.
En ce sens, Trump a bel et bien déclaré une guerre intérieure : non pas aux armes lourdes, mais à coups de mots, de lois d’exception et de mise en scène militaire.
La guerre extérieure : Donald Trump punit le monde
Le même schéma se retrouve à l’échelle internationale. Loin de chercher la coopération, Trump a mené une guerre économique contre la quasi-totalité du globe. Tarifs douaniers punitifs contre la Chine, mais aussi contre les alliés historiques : Union européenne, Canada, Mexique.
Ce n’est pas une simple stratégie de protectionnisme : c’est une logique de sanction. Ceux qui ne lui obéissent pas sont punis. Ceux qui contestent son rapport de force sont ciblés.
Ainsi, la doctrine Trump n’est pas seulement nationaliste : elle est punitive. Elle oppose en permanence un “eux” à combattre à un “nous” à protéger.
Le paradoxe du Nobel de la paix
Et pourtant, Donald Trump affirme qu’il mérite le prix Nobel de la paix. Il le répète dans ses discours, rappelant ses initiatives diplomatiques, ses tentatives de rapprochement au Moyen-Orient ou ses pourparlers avec la Corée du Nord.
Mais comment prétendre à la paix quand on revendique la haine de ses adversaires et qu’on brandit la guerre économique comme instrument central de politique étrangère ?
Il y a là une dissonance assumée : Trump veut être perçu à la fois comme un homme fort qui punit et comme un faiseur de paix qui mérite une reconnaissance mondiale.
Pouvoir et fortune : la paix comme produit d’influence ?
À cette contradiction s’ajoute une donnée brute : son enrichissement personnel. Selon Forbes, en l’espace d’un an (période incluant sa réélection) sa fortune aurait plus que doublé, passant d’environ 2,3 à 5,1 milliards de dollars.
Cela pose une question symbolique : peut-on prétendre défendre la paix universelle tout en transformant son pouvoir politique en levier d’enrichissement privé ? N’y a-t-il pas une confusion entre leadership politique et branding personnel ?
Le rêve de Trump : paix ou soumission ?
Au fond, la question n’est pas de savoir si Donald Trump veut la paix. Il la revendique, il la cite, il l’érige en trophée à conquérir.
Mais tout, dans ses actes, semble indiquer qu’il ne conçoit pas la paix comme une coexistence, mais comme une domination.
Alors, que veut réellement Donald Trump ? La paix, la soumission des autres, ou encore autre chose que l’on n’a pas encore décelé ?