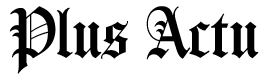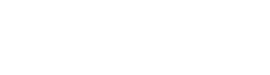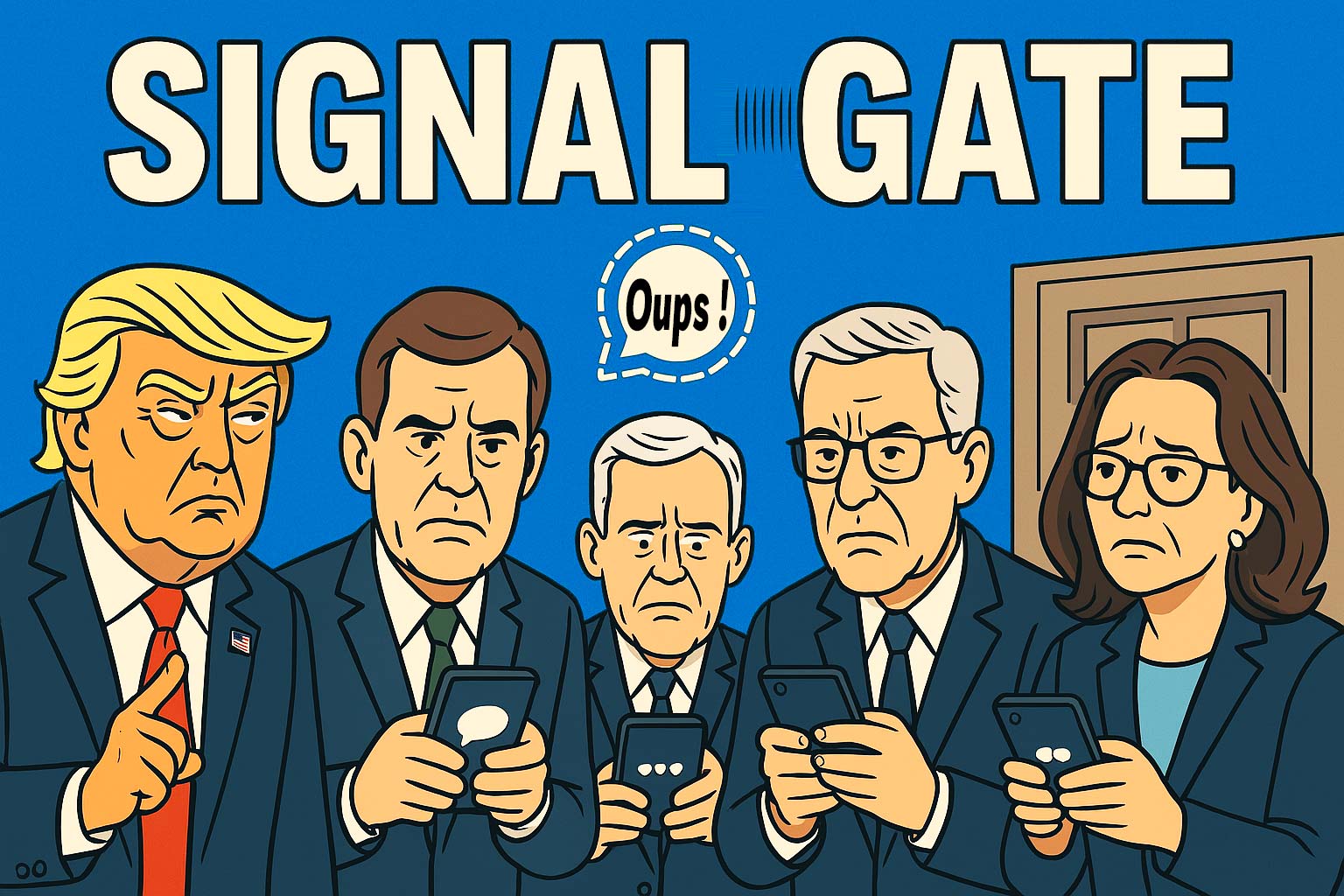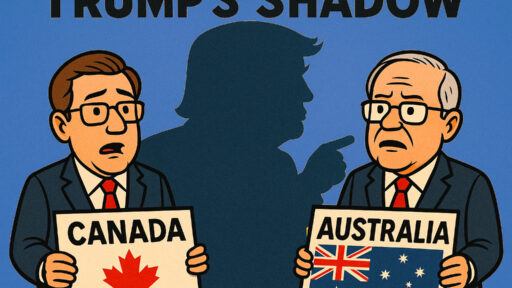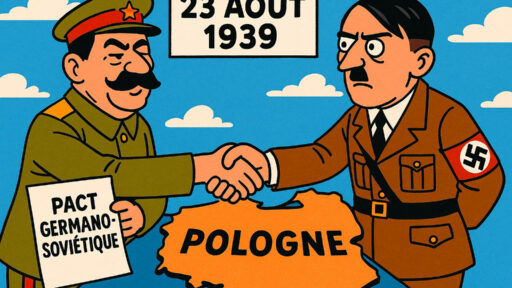Ou comment l’élite sécuritaire de Washington a joué à la guerre… sur une appli.
La conversation de trop sur « Signal »
Tout commence par une erreur grotesque. Le 15 mars, un groupe « Signal » réunit, entre autres, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz. L’objet ? Discuter des frappes imminentes contre les Houthis au Yémen.
Sauf qu’un intrus s’invite dans le salon privé : Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, ajouté par erreur. Ce qu’il découvre est édifiant. Loin d’un simple échange anodin, il lit des détails d’opérations en cours : type d’armement, séquence des frappes, météo sur la zone, et confirmation d’élimination de cibles.
Le tout, partagé… via une application de messagerie privée, non sécurisée, installée sur des téléphones personnels. Autodestruction des messages programmée dans les 4 semaines. Le tout en dehors des protocoles d’archivage du Federal Records Act.
Le déni comme doctrine
Face au scandale, l’administration Trump suit un schéma bien rodé : nier, puis discréditer, puis banaliser.
Pete Hegseth, interrogé à Hawaï, nie avoir envoyé « des plans de guerre ». Waltz crie au « hoax ». Donald Trump parle d’un « glitch », le seul en deux mois. Même la porte-parole Karoline Leavitt en rajoute une couche : « Ce n’était pas de l’information classifiée ».
Sauf que les faits contredisent cette ligne. The Atlantic publie ensuite les messages. On y lit ce que tout professionnel du renseignement qualifierait sans hésiter de données sensibles. Raja Krishnamoorthi, lors d’une audition au Congrès, lève une copie des messages et tranche :
“C’est classifié. Ce sont des plans d’opérations militaires. Point.”
Raja Krishnamoorthi – Membre du Parti démocrate
Le Pentagone avait prévenu. Ils n’ont pas écouté.
L’affaire aurait pu être évitée. Trois jours après les fuites, un mémo OPSEC du Pentagone circule : l’App « Signal » est vulnérable. Des groupes russes pourraient exploiter des failles pour accéder aux communications chiffrées.
Le document rappelle que même des informations « non publiques mais non classifiées » ne doivent pas être partagées sur ces applis. Pourtant, c’est exactement ce que Hegseth et ses collègues ont fait. À ce stade, on n’est plus dans la maladresse. On est dans l’irresponsabilité stratégique.
Enquête ouverte, administration acculée, c’est le début du « Signal Gate »
Le Congrès n’en reste pas là. Deux commissions – Sénat et Chambre – auditionnent les responsables impliqués.
Gabbard plaide l’oubli. Ratcliffe s’emmêle dans ses justifications. Certains sénateurs demandent l’accès intégral aux messages. D’autres exigent des démissions. Plusieurs élus républicains, dont Don Bacon et Roger Wicker, expriment leur inquiétude : la Russie et la Chine auraient pu intercepter ces données en temps réel.
Et ce n’est que le début. Car juridiquement, des chefs d’inculpation sont envisageables :
– Négligence en matière de sécurité nationale,
– Violation du Federal Records Act,
– Usage de dispositifs personnels pour des communications sensibles,
– Mensonges éventuels sous serment.
Trump, pour l’instant, protège son cercle rapproché. Mais l’administration est sur une ligne de crête. Un faux pas de plus, et les démissions deviendront inévitables.
Les Five Eyes (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, et Royaume-Uni ) ainsi que l’Europe, prennent leurs distances
Le Signal Gate n’est pas une simple affaire de comm’. C’est un révélateur.
Il confirme ce que plusieurs chancelleries européennes pressentaient : l’Amérique trumpienne n’est plus un partenaire fiable en matière de renseignement.
Ces dernières 72 heures, des signaux faibles sont apparus :
– Londres a suspendu certains partages d’infos avec le Pentagone,
– Ottawa a demandé un rapport d’impact de ses services de renseignement,
– Paris, Berlin et probablement d’autres capitales prennent des notes.
Le lien transatlantique n’est pas rompu, mais il est fragilisé. Et à la vitesse où vont les choses, l’Europe va devoir sérieusement réfléchir à l’autonomie de ses canaux d’analyse et de réaction. Moins par défiance politique que par nécessité opérationnelle.
Quand les cow-boys perdent la boussole
Un gouvernement qui revendique « le retour à l’ordre » tout en envoyant des plans de frappe sur une messagerie privée ? C’est plus qu’un paradoxe. C’est un symptôme.
L’Amérique de Trump veut apparaître forte. Mais une puissance qui ne maîtrise plus sa propre chaîne de commandement devient vulnérable. Non pas par faiblesse militaire, mais par effondrement du sérieux.
Et pour ses alliés, une seule question devient centrale :
Jusqu’où peut-on encore faire confiance à une administration qui traite la sécurité comme un fil de discussion de groupe WhatsApp ?