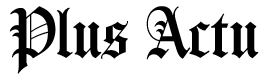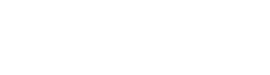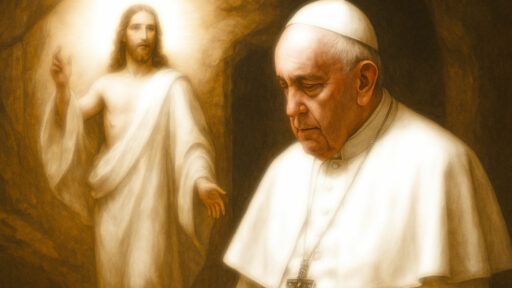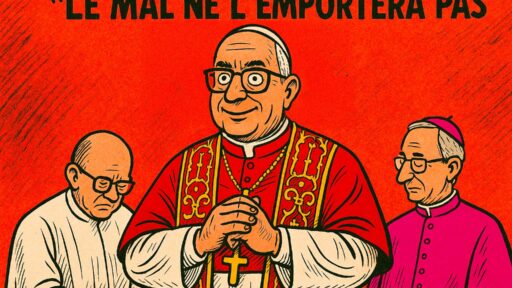En France, l’eau minérale est censée être sacrée. Intouchable, vierge de tout traitement, puisée à la source et embouteillée sans que l’homme n’y mette autre chose que du plastique. C’est la promesse, gravée dans le marbre du Code de la santé publique. Mais que reste-t-il de cette promesse quand des géants comme Nestlé Waters ou le groupe Alma sont accusés d’avoir transformé leurs eaux de source en eaux de ville… en douce ?
Eaux minérales : la promesse d’un monde sans filtre
Une eau minérale naturelle, pour avoir le droit de porter ce nom, ne doit subir aucun traitement chimique ni désinfection, contrairement à l’eau du robinet. Seuls quelques procédés mécaniques légers sont autorisés, à condition qu’ils ne modifient ni la composition ni la pureté d’origine. Cette définition protège un label qui vaut de l’or : celui de la confiance du consommateur.
Ce que l’on découvre
En 2024, plusieurs enquêtes journalistiques et administratives, notamment celles de l’Anses et de l’IGAS, ont révélé une pratique généralisée : traiter des eaux minérales comme on traite l’eau du robinet. Filtrations fines, rayons UV, charbon actif : des techniques interdites pour l’eau minérale… mais tolérées pendant des années, dans un silence complice. Résultat ? Des marques comme Perrier, Vittel, Hépar, Contrex (Nestlé) ou Cristaline, Saint-Yorre, Vichy Célestins (groupe Alma) sont aujourd’hui dans la tourmente.
Pourquoi ces traitements ? Parce que la source n’est plus si pure
Ce que ces industriels ont voulu cacher, ce n’est pas un simple détail technique. C’est un effondrement de la qualité de certaines sources, polluées par les activités humaines : bactéries fécales, pesticides, solvants, résidus médicamenteux. Nestlé a même dû détruire deux millions de bouteilles de Perrier, contaminées par des bactéries d’origine fécale en 2024.
Autrement dit : pour continuer à vendre une « pureté naturelle », on a maquillé des eaux à risque à coups de technologies interdites.
La transparence de l’Etat en bouteille elle aussi ?
L’affaire aurait pu éclater plus tôt. Mais pendant des années, l’administration a fermé les yeux. Et certains documents confidentiels, comme la note de l’Anses révélée par Le Monde, montrent que l’État savait, mais n’a rien dit.
Pire : les liens entre Nestlé et plusieurs responsables publics (dont certains proches de l’Élysée) posent question. L’Élysée aurait facilité, selon certaines sources, des aménagements réglementaires pour éviter un scandale économique. Une collusion ? Ce sera à la justice d’en juger. Une commission d’enquête sénatoriale est en cours, mais Alexis Kohler, bras droit du président Macron, a refusé d’y témoigner, invoquant la séparation des pouvoirs.
Où en est-on aujourd’hui sur la transparence de l’eau ?
L’association Foodwatch a porté plainte contre Nestlé et Alma pour tromperie aggravée et pratiques commerciales déloyales. Les deux groupes risquent gros. Le procès est en cours, et l’opinion publique commence à se réveiller. Plusieurs enseignes ont discrètement réétiqueté leurs produits, et des distributeurs songent à revoir leurs approvisionnements.
Mais la vraie question est ailleurs : que reste-t-il de la confiance dans les labels, dans la transparence industrielle, dans la parole de l’État ?
Une goutte d’eau trouble dans un océan d’indifférence
Ce scandale dépasse la simple question de la bouteille d’eau. Il dit quelque chose d’essentiel sur notre rapport à l’environnement, à la vérité, et à ceux qui prétendent veiller sur notre santé.
Il ne s’agit pas de hurler au complot, mais de poser cette question simple : Comment en sommes-nous arrivés là ?
Et surtout : allons-nous refermer le robinet de la vigilance une fois l’orage médiatique passé ?