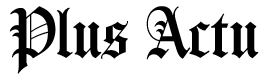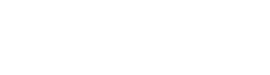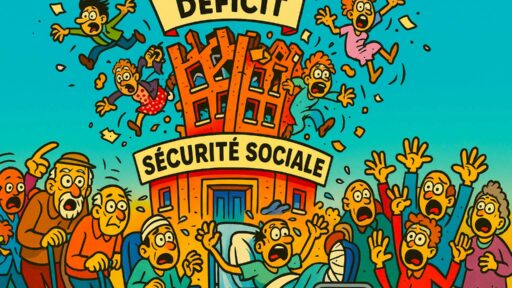Quand l’histoire se transmet en pierre d’un côté, en capital de l’autre
À l’heure où la France s’interroge une fois de plus sur une éventuelle surtaxation de l’héritage, encore faut-il savoir de quoi on parle.
Comparer la philanthropie volontariste de certains milliardaires américains comme Bill Gates à l’héritage typiquement français ( souvent modeste, souvent matériel, parfois simplement une maison de famille ) est-ce pertinent… ou parfaitement absurde ?
Faut-il vraiment mettre sur le même plan un legs de plusieurs milliards orchestré via fondation et déduction fiscale, et le fruit d’une vie de travail transmis à ses enfants, après impôts, retraites et contributions diverses ?
Autrement dit : est-ce une comparaison éclairante… ou un tour de passe-passe idéologique pour culpabiliser les classes moyennes ?
Hériter en France : un enracinement dans la pierre et le droit
En France, l’héritage est une affaire sérieuse. Il se mesure souvent en hectares, en façades, en murs chargés de souvenirs. Le patrimoine immobilier représente près de 60 % de la richesse transmise entre générations. On hérite d’une maison, d’un appartement, d’une exploitation agricole ou viticole. Et on le fait selon des règles strictes : la réserve héréditaire impose qu’une part importante du patrimoine revienne aux enfants, quoi qu’il arrive.
Ce système repose sur une idée : l’héritage est un droit, pas une faveur. Il garantit une continuité familiale mais aussi une certaine égalité entre enfants. En 2021, la France a enregistré 424 milliards d’euros transmis par héritage, soit près de 15 % du PIB, un record historique. Ce pic s’explique en partie par une surmortalité liée à la pandémie (+60 000 décès) et un rattrapage administratif des successions bloquées durant les confinements.
L’impôt sur les successions, quant à lui, peut grimper jusqu’à 45 %, bien que de nombreuses exonérations (notamment pour la résidence principale) viennent tempérer la rigueur du barème.
Cette vision repose sur la mémoire plus que sur la rentabilité. Le bien hérité est souvent sacralisé : il faut le conserver, parfois au prix de dettes ou de conflits familiaux. Hériter, c’est souvent entretenir une charge, pas exploiter un actif.
Hériter aux États-Unis : une logique de capital mobile
À l’inverse, les États-Unis ont fait de l’héritage une affaire de liberté privée. Ici, pas de réserve héréditaire : on peut tout transmettre à un tiers, à une fondation, ou ne rien transmettre du tout. Le testament est roi.
Ce qui se transmet, ce n’est pas une maison à restaurer, c’est une capacité à investir : actions, entreprises, assurances-vie, comptes en fiducie (trusts). L’immobilier ne représente que 30 % à 35 % du patrimoine transmis, selon les données de la Federal Reserve.
La fiscalité suit cette logique libérale : l’impôt fédéral sur les successions (estate tax) ne s’applique qu’au-delà de 13,6 millions de dollars par héritier (chiffres 2024), autant dire jamais pour les classes moyennes. En pratique, moins de 0,1 % des successions sont taxées.
La logique est celle du capitalisme entrepreneurial : on transmet moins un souvenir qu’une capacité à rebondir. Et si les enfants échouent ? C’est leur problème.
Deux visions du monde qui s’affrontent… mais s’influencent
Ce contraste en dit long sur deux visions de la société :
- En France, on veut limiter les inégalités de naissance par une fiscalité redistributive, quitte à figer une part de la richesse dans des biens peu liquides.
- Aux États-Unis, on valorise la liberté individuelle, mais au risque de laisser s’installer une aristocratie financière bien plus puissante que les nobles français du XIXe siècle.
Mais les lignes bougent. En France, les jeunes héritent plus tard, souvent après 50 ans. La classe moyenne investit désormais via l’assurance-vie, les SCPI, ou la bourse, brouillant la frontière entre héritage immobilier et financier. Aux États-Unis, les inégalités explosent, au point que certains démocrates proposent… de renforcer l’impôt sur les successions.
La France et les États-Unis s’observent, se critiquent, mais se rapprochent peut-être sur un point : l’héritage devient un enjeu politique majeur dans une société où la mobilité sociale s’effondre.
Héritage ou transmission ?
Au fond, la vraie question n’est pas de savoir si l’on transmet un château ou un portefeuille d’actions. La vraie question, c’est : transmet-on un levier ou un fardeau ? Une identité ou une opportunité ?
Dans un monde en mutation rapide, où la propriété devient parfois une prison, et où l’investissement devient parfois un mirage, il faudra peut-être repenser l’héritage non pas comme un dû, mais comme une responsabilité intergénérationnelle. Transmettre, oui – mais transmettre quoi, pourquoi, et à quelles conditions ?