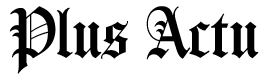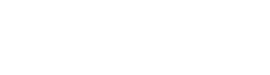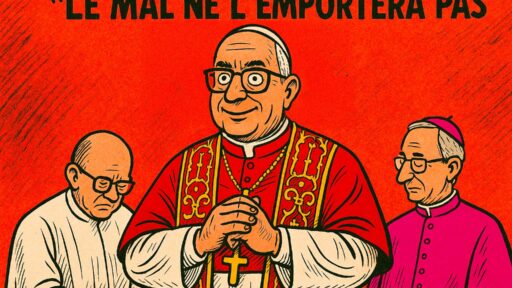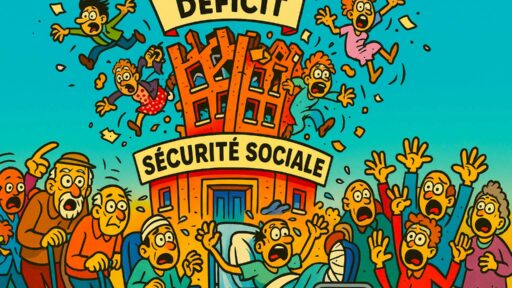À l’heure où s’est éteinte la lumière du chef de l’église catholique, pourquoi ne pas se poser la question : d’où venons-nous ?
Cette interrogation, ancestral, oppose depuis toujours deux visions du monde : celle des croyants, pour qui tout commence par un acte divin; celle des athées, qui cherchent une explication sans Dieu.
Deux camps, un mystère, et toujours la même tension : comment l’univers a-t-il commencé ?
L’énigme du commencement : croyants et athées sur le même fil
Aussi étonnant que cela puisse paraître, croyants et athées se retrouvent, lorsqu’il s’agit de l’origine de tout, sur la même ligne de crête. Chacun, à sa manière, est confronté à la même impasse : d’où vient ce qui est ?
- Le croyant affirme : Dieu est la cause première, non causée, hors du temps.
- L’athée matérialiste affirme : l’univers est auto-suffisant, éternel ou issu du vide quantique.
Dans les deux cas, on pose un principe irréductible, qu’on ne peut pas expliquer davantage sans tomber dans la régression infinie.
C’est ici que la célèbre question de Richard Dawkins, dans Pour en finir avec Dieu (2006), prend tout son poids provocateur :
« Si vous prétendez que l’univers fut créé par Dieu, j’ai le droit de vous demander, qui a créé Dieu ? »
Mais cette question, très efficace rhétoriquement, échoue face à la conception classique de Dieu dans le christianisme, qui postule un être non créé, immatériel, éternel, nécessaire.
Stephen Hawking : l’univers peut se créer de lui-même ?
Le célèbre physicien britannique Stephen Hawking, dans The Grand Design (2010), propose une thèse aussi fascinante que déconcertante :
« Parce qu’il existe une loi comme la gravité, l’univers peut se créer de lui-même, à partir de rien. »
C’est la thèse d’un univers auto-engendré, où le vide quantique, instable par nature, permet l’apparition spontanée d’un univers. Le problème ? Le « rien » dont parle Hawking n’est pas le néant absolu, mais un vide structuré, soumis à des lois physiques. Alors surgit une autre question :
Pourquoi ces lois ? Pourquoi cette cohérence ?
Même débarrassée de Dieu, l’explication scientifique atteint une frontière. Elle est confronté à sa propre limite. Elle décrit comment les choses arrivent, mais n’explique pas pourquoi elles existent. La cause de l’existence elle-même reste une énigme vertigineuse. Et pourtant c’est bien le pourquoi qui est en question, car il est le fondement même de la croyance en Dieu.
Genèse et Big Bang : intuition mystique ou coïncidence troublante ?
Dans le récit biblique de la Genèse (Genèse 1, 3), on lit :
« Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. »
Ce verset, écrit plusieurs millénaires avant la science moderne, raconte une irruption soudaine de lumière, suivie par la structuration progressive du cosmos.
Or que décrit la théorie du Big Bang ? Un point d’origine, une expansion brutale de chaleur et de lumière, survenue il y a environ 13,8 milliards d’années, à partir d’un état de densité et de température extrêmes. Donc là aussi l’explosion de lumière crée en quelques seconde ce qui sera la vie.
Bien sûr, le texte biblique n’a pas valeur de démonstration scientifique. Mais difficile de ne pas remarquer une résonance troublante : la lumière comme premier acte fondateur. Est-ce une coïncidence ? Une intuition symbolique ? Ou un message ?
Science et foi : deux registres, un même vertige
Il est temps de sortir de l’opposition stérile entre la science et la foi. Ces deux démarches ne parlent pas la même langue :
- La science demande : Comment cela fonctionne-t-il ?
- La foi demande : Pourquoi cela existe-t-il ? Quel sens cela a-t-il ?
Comme le disait Blaise Pascal :
« La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la dépassent. »
Rejeter Dieu n’est pas absurde, mais cela oblige à assumer jusqu’au bout le vertige du néant, la gratuité totale de l’univers, et l’absence de sens ultime.
Croire, ce n’est pas renoncer à penser. C’est accepter que la pensée seule ne suffit pas à tout expliquer.
En conclusion : et si le mystère était le début, et non la fin ?
Croire en un Dieu créateur ne signifie pas tuer la raison. Cela peut être un acte de lucidité : reconnaître que tout ne se réduit pas aux mécanismes.
D’ailleurs, dans un monde où tout a une cause, un ordre, une cohérence, n’est-il pas étrange de penser que le tout en serait dépourvu ?
Reste cette question simple et déstabilisante, que l’on peut retourner à tous :
Comment est-ce que ça commence ?
La science n’a pas fini de chercher. La foi n’a pas fini de s’interroger. Et peut-être que c’est justement dans cette tension-là que l’homme trouve sa grandeur.