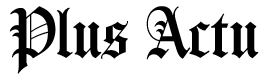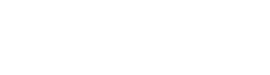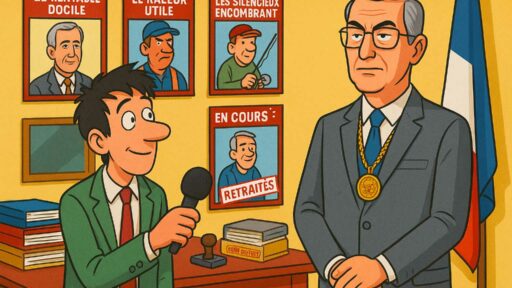Il y a des silences qui coûtent cher. Celui qui entoure la suspension de la réforme des retraites en est un. On pourrait croire à une victoire, à un retour en arrière salvateur, à ces 63 ans retrouvés comme un droit arraché à la raison comptable. Si cela était une annulation on serait revenu déjà à 62 ans pas à 63 ans. Différence entre suspension et annulation : on s’arrête là où on en est. Mais derrières les mots « suspension », « pause », « réévaluation », se cache une vérité plus âpre : ce n’est pas un abandon, c’est un report. Et les reports, en économie comme en médecine, ont toujours un prix.
Bercy a sorti ses calculs, froids et précis : 500 millions d’euros en 2026, puis 3 milliards en 2027. Des chiffres qui, mis bout à bout, dessinent une courbe ascendante, presque vertigineuse. La Cour des comptes, elle, voit plus loin, et ses prévisions sont sans appel : 8 à 13 milliards par an d’ici 2035, soit exactement ce que la réforme de 2020 devait économiser. On comprend alors la manœuvre : en gelant la réforme, on gèle aussi ses économies promises. On ne supprime pas la dette, on la décale. On ne résout pas la crise, on la lègue.
Et si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout, si l’on ose regarder l’ardoise dans son ensemble, le chiffre donne le vertige : 92,6 milliards d’euros cumulés entre 2026 et 2035. Car cette estimation, bien plus qu’un simple total, révèle une vérité brutale : les déséquilibres ne se contentent pas de persister, ils s’aggravent, année après année. Les coûts ne sont pas figés, ils s’emballent, portés par la démographie, les mécanismes économiques, et cette inertie financière qui transforme chaque report en une dette plus lourde pour demain.
Cela ne veut pas dire que ce n’est pas possible, mais qu’il faudrait trouver le moyen de le financer, avant même de l’annoncer.
L’âge et le temps : un jeu dangereux
Tout repose sur deux variables, aussi simples en apparence que redoutables dans leurs conséquences : l’âge de départ et la durée de cotisation. Si l’on ne touche qu’au premier — en revenant à 63 ans sans modifier le reste —, les coûts restent maîtrisables à court terme. Mais c’est compter sans l’effet domino. Les marchés, d’abord, qui n’aiment rien tant que la prévisibilité, et qui pourraient sanctionner cette instabilité par des taux plus élevés, une fuite des capitaux, ou une défiance accrue. Les entreprises, ensuite, qui reportent déjà leurs investissements depuis dix-huit mois, comme si le pays était entré dans une forme de coma économique, où chaque décision est ajournée dans l’attente d’un signal clair. Enfin, les générations futures, à qui l’on demande implicitement de payer la note — non pas dans dix ans, mais dans vingt ou trente, quand le déficit, gonflé année après année, deviendra ingérable.
Christian Saint-Étienne, économiste et ancien ministre, le dit sans détour : « La France n’est pas une île. Nous vivons dans une économie ouverte, où nos forces — l’aéronautique, le luxe — dépendent de la confiance des partenaires étrangers. Or, aujourd’hui, nous envoyons un signal ambigu : nous refusons les réformes structurelles, mais nous ne proposons rien pour les remplacer. » Traduction : on veut le beurre, l’argent du beurre, et la vache en bonne santé. Sauf que la vache, justement, commence à tousser, donne beaucoup moins de lait et quelques coups de pied.
Où trouver l’argent ? Le casse-tête des 13 milliards
Le gouvernement se retrouve donc face à une équation impossible : comment financer un trou de 13 milliards sans alourdir la dette, sans étouffer la croissance, et sans braquer définitivement l’opinion publique ? Les pistes existent, bien sûr. On pourrait rogner sur les dotations aux collectivités locales, réduire le taux de remplacement des fonctionnaires, ou encore ressusciter un ISF ciblé sur les liquidités. Mais chacune de ces solutions a son talon d’Achille : les premières fragilisent les territoires, la seconde risque de démoraliser une fonction publique déjà sous tension, et la troisième soulèverait un tollé chez les contribuables aisés : ceux-là mêmes qui, paradoxalement, sont aussi les plus mobiles fiscalement.
Et puis, il y a l’ironie du sort : même en combinant toutes ces mesures, on n’y arriverait pas. Toujours selon Christian Saint-Étienne : « Vous pouvez gratter 5 ou 6 milliards ici ou là, explique un haut fonctionnaire sous couvert d’anonymat, mais ces économies étaient déjà prévues ailleurs. C’est comme si vous vidiez un seau pour remplir une baignoire percée. » Autrement dit, on se donne l’illusion d’agir, tout en creusant un peu plus le déficit.
L’instabilité, ce luxueux poison
Car le vrai coût, peut-être, n’est pas celui des retraites. C’est celui de l’incertitude. Depuis juin 2024, la France s’enfonce dans une crise politique dont l’OFCE évalue déjà l’impact à 0,5 point de croissance en moins — soit 15 milliards d’euros envolés en fumée. Des entreprises qui hésitent à embaucher, des investisseurs qui attendent, des ménages qui consomment moins… L’instabilité n’est pas un détail. C’est un multiplicateur de crises.
Alors, quel est le pire scénario ? Celui où l’on suspend la réforme et où les marchés, lassés, tournent le dos à la France ? Ou celui où l’on persiste dans l’immobilisme, en espérant que le temps arrangera les choses — alors même que les déséquilibres démographiques, eux, ne attendront pas ?
La question qui reste en suspens
Au fond, cette suspension est moins une solution qu’un symptôme. Celui d’un pays tétanisé par ses contradictions : une nation qui veut préserver son modèle social, mais qui refuse les sacrifices pour le financer ; qui rêve de croissance, mais qui repousse les réformes qui pourraient la stimuler ; qui craint l’avenir, mais qui rejette les choix difficiles.
Faire ou ne pas faire telle est la question ?