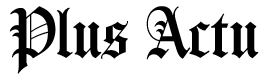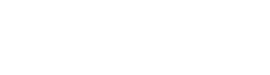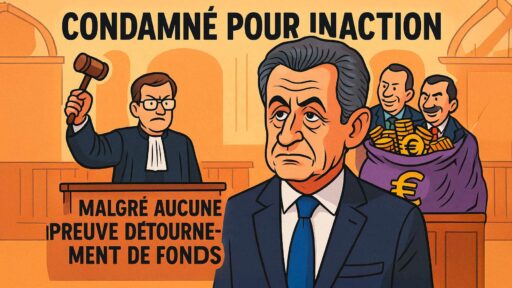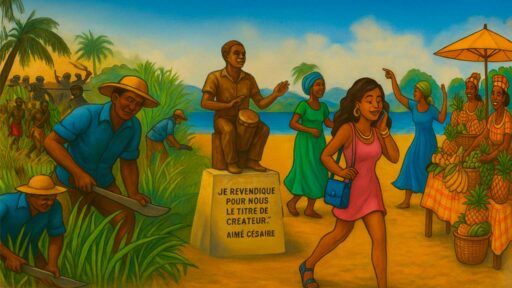« Les facultés françaises ne sont plus un lieu de débat contradictoire. »
Caroline Fourest
Cette phrase dit un malaise profond. L’université, censée être le cœur battant de la République, l’espace où l’on apprend à douter et à se confronter sans se détruire, devient un terrain d’intimidation. Ce n’est plus l’agora, c’est la peur qui règne.
L’université sous escorte
Quand il faut un cordon de CRS pour qu’une conférence ait lieu, c’est que l’université a cessé d’être une université. Quand un professeur ou un invité doit être escorté pour parler, c’est que la parole n’est plus libre, mais sous surveillance.
Une minorité, persuadée de détenir la vérité morale, impose sa norme par la menace. Le contradictoire est annulé, chahuté, empêché. L’université devrait être un laboratoire d’idées. Elle devient un sanctuaire idéologique.
La meute numérique
La menace ne se joue plus seulement dans les amphithéâtres. Elle s’est déplacée en ligne. Harcèlement, campagnes de lynchage, menaces de mort : les réseaux sociaux ont inventé une police de la pensée, diffuse, invisible, mais redoutable.
Les algorithmes enferment chacun dans une bulle de certitudes. On ne dialogue plus, on s’auto-confirme. Dès lors, la contradiction n’est plus une stimulation, mais une agression.
La démocratie assiégée
Ce climat déborde largement du campus.
Des étudiants juifs agressés pour ce qu’ils sont.
Des intellectuels menacés de mort, comme Caroline Fourest, contrainte de vivre sous protection permanente.
Des parlementaires harcelés, des permanences saccagées parce qu’ils ont voté une loi jugée « incorrecte ».
La démocratie ne meurt pas d’un coup d’État. Elle se délite par mille intimidations, jusqu’à ce que plus personne n’ose parler autrement.
Le piège des extrêmes
Cette peur nourrit les radicalités.
L’extrême gauche justifie ses violences au nom de la lutte contre les « mauvaises idées ».
L’extrême droite prospère sur le rejet du politiquement correct et la nostalgie d’une parole « libérée ».
Entre les deux, l’espace démocratique se rétrécit. Ceux qui voudraient simplement discuter reculent, faute de pouvoir le faire sans être insultés, menacés ou frappés.
Résister à la dictature de la pensée unique
Alors, que faire ? Se résigner ? Renoncer à l’agora ? Certainement pas. Nous devons résister, coûte que coûte.
Nous devons résister à la terreur intellectuelle.
Nous devons résister en maintenant les débats, même sous protection.
Nous devons résister en réaffirmant que l’université n’est pas une chapelle, mais un lieu d’apprentissage du doute.
Nous devons résister en brisant les bulles algorithmiques, en exigeant de la transparence et en réintroduisant le contradictoire.
Car il n’y a pas de démocratie sans courage. Pas de République sans désaccord. Pas d’avenir commun sans la certitude que l’autre a le droit de parler — surtout quand ses mots dérangent.